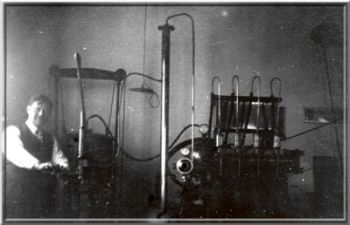Histoire d’un hameau , la Place
La Place entre les deux guerres
par
Ferdinand Barriquand
Quand je remontais du bourg de Coublanc en rentrant de l’école pour retourner au hameau de La Place, je trouvais, et on trouve toujours, à main droite, à cent
cinquante mètres avant d’arriver au premier sommet du triangle des routes qui délimitent la partie centrale de ce hameau, la limonaderie qui appartient à madame
Lachat.
C’était à l’époque la maison de ses grands-parents Lacroix. M. Joseph Lacroix avait l’esprit toujours
tourné vers le progrès :

en faisait foi une automobile que j’ai vue plus tard hors d’usage, et qui fut une des premières de la région. C’était
une berline blanche d’avant- guerre, à pneus
pleins cloutés, qui demeura longtemps devant sa maison, devant laquelle je passais à partir de 1906 pour descendre à l’école. Il avait fait construire un grand atelier
où il fabriquait de la limonade, La Régionale. Il fabriquait aussi, dans un deuxième atelier, de la glace dans des bacs en tôle qui donnaient leur forme au pain de
glace. Ceux-ci étaient livrés par lui-même sur un rayon de plus de trente kilomètres au moyen d’un camion automobile. — Il avait en plus une autre voiture, une
Delogère et Clayette. L’entreprise employait, en plus de la famille, trois ouvriers en permanence... La commune alors n’était pas électrifiée. Monsieur Lacroix
avait un moteur “ à gaz pauvre ”, fonctionnant à partir de la houille, pour entraîner les machines.
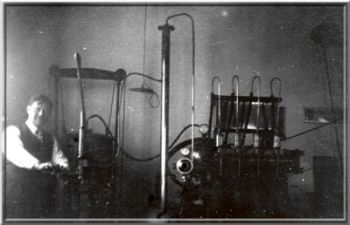

En arrivant à la Place même, dans le premier angle du triangle qui la constitue, on tombe sur une bascule qui a été installée
entre 1915 et 1920 par une
association de cultivateurs. Plus loin, au-delà d’une petite prairie qui a depuis rétréci, vers l’angle ouest de la Place, il y avait un étang, qui a été comblé et
transformé en parc récemment. Je me souviens d’avoir fait de la moto sur cet étang gelé, et d’en être sorti promptement en entendant des craquements…

Le hameau de La Place était animé d’une grande vie commerciale et artisanale. Il y avait surtout des tisseurs à domicile
sur des métiers à tisser la soie. Ils
faisaient fonctionner ces métiers de bois avec leurs pieds, et leurs mains manœuvraient les navettes. Les commerces étaient nombreux : l’hôtel-charcuterie de
madame Monchanin (appelée, du prénom de son mari décédé, “ la Jéromette ”) ; le magasin de tissus de madame Émilie Joly joint à la boutique de son époux Rémy
Joly, maître tailleur, employant deux ouvriers ; l’épicerie bien organisée de monsieur Dumoulin, qui faisait aussi des tournées, et qui eut le malheur de voir ses
enfants mourir de tuberculose. Vers 1921, au moment de l’électrification, monsieur Déverchère, électricien, revint de Condrieu s’installer au pays et ouvrit pour sa
femme, à cinquante mètres de l’épicerie Dumoulin, un magasin casino.

Il y avait aussi deux charrons-forgerons, Rémy Grapeloup (dans la maison Maurice Villard aujourd’hui), et Fouillet (dans la maison
Bernard Berthier), un
boulanger, Vermorel (dans la maison Maurice Lacôte), un menuisier, Bénédict Lacôte ; et des cultivateurs qui se nourrissaient des produits de leur ferme, et qui
tissaient aussi la soie à domicile, durant l’hiver. Claudius Grapeloup tissait et faisait des sabots.
La vie était moins pressée que de nos jours. L’été, on voyait se réunir tisseurs et autres travailleurs vers
les huit heures du matin ; ils venaient avec leur bol de
soupe à la main. Le groupe le plus nombreux s’installait en face de l’hôtel et boucherie-charcuterie de madame veuve Monchanin, dans la cour de la maison de
Claudius Barriquand (tisseur lui aussi), cour ombragée par deux acacias. On s’asseyait sur la bergère et sur des chaises apportées pour la circonstance. Je m’en
souviens bien : c’était l’heure où les vaches étaient traites, à la ferme de mes parents (l’actuelle maison Guillemier) ; je les emmenais au pré, du côté de
Bonnefons.
Chaque jour de la semaine, il y avait, à partir de la Place, un départ de courrier ; la voiture en prenait au bourg, à Cadolon
et sans doute à Saint-Igny ; elle le
portait jusqu’à la gare de Chauffailles, en y conduisant aussi les éventuels voyageurs. De même pour le retour. Pendant la guerre de 14-18, c’était Maria Auclair (la
mère d’Antonin) qui, comme son mari était à la guerre, assurait le service avec le cheval et la voiture. Après guerre, le service fut assuré par Prosper Chervier, un
fils de Victor Chervier, qui habitait la maison qui a été démolie cette année en juin (maison Delomier-Martin) pour permettre l’agrandissement de l’usine de La
Place (Magnillat devenue Coublanc-Textiles). À l’emplacement de l’usine, il y avait un pré, avec un puits au centre, où pâturait le cheval du courrier. Le service du
courrier fut ensuite repris par Paul Collet, relayé quand il était malade par Paul Christophe d’Écoche, et parfois par moi-même, avec deux voitures automobiles,
une berline et une fourgonnette.
Un jour, vers 1920, comme je m’amusais avec les deux aînés de la famille Villard, Roger, né en 1910, et Émilien, né
en 1911, sous les deux grands épicéas qui
s’élevaient à l’angle de La Place du côté de Mars et Maizilly, nous aperçûmes deux belles voitures qui étaient stationnées dans la prairie du cheval ; il y avait
rumeur que la prairie était vendue pour qu’on y construise une usine ; comme des gamins curieux nous courûmes voir ce qui se passait. C’était des Parisiens, dont
les frères Magnillat, qui avaient acheté le pré. Et avec eux un géomètre, pour délimiter le tracé de l’usine. Ils nous embauchèrent pour porter les jalons et les fixer...
Les travaux ayant été vite menés à bien, un jour nous entendîmes le son d’un moteur à gaz pauvre ; il fournissait à la fois l’énergie motrice des métiers et le
courant électrique de l’éclairage. Quelques jours plus tard, l’usine fut mise en route. Elle fabriquait par exemple de la toile de parapluie. Elle employa de nombreux
ouvriers des alentours, et j’y travaillais durant deux ans, à partir de treize ans et demi, avant de descendre travailler à l’usine du Bourg durant un peu plus
longtemps.
Comme c’était la vogue des boules, la cour de l’usine servit pour des jeux de boules. On se reporta ensuite chez Claudius Grapeloup,
puis chez Victor
Chambrade, qui, ayant cessé son activité de tisseur, avait installé un café dans sa cabine, et dans son jardin des jeux de boules ; enfin, chez la Stéphanie Guérin. Le
jeu devenant de plus en plus populaire, nous avons formé la Boule de La Place, car il y avait un gros noyau de joueurs après la guerre de 39-45.
Les premières fêtes de La Place furent organisées par Émile Devaux, qui tenait le café de l’hôtel Monchanin
après madame Debiesse. Il y avait des courses à
pied et des courses de vélo.
On fit aussi la fête dans la cabine de Victor Chambrade autrefois occupée par ses métiers à tisser ; Marcel Martin
y organisa le bal ; Louis Villard gagna la
course à pied. Plus tard, la fête eut lieu dans le pré de Gaston Déverchère, devant la casino ; puis chez la Stéphanie Garin, épicière qui était la locataire de la maison
Dumoulin. Après guerre, cela continua, avec l’apparition de la Commune libre de La Place, avec son maire. Mais c’est une autre histoire. À l’époque dont je parle,
La Place avait l’honneur d’avoir le vrai maire de Coublanc, Rémi Joly, qui mourut en 1943 après presque vingt ans de mandat.
Le hameau de La Place était enfin le lieu privilégié de la “ Fête à Dieu ”, à la fin du mois de juin. À l’entrée du hameau, une espèce d’arc de triomphe était dressé
avec trois passages. À chaque sommet du triangle de La Place un reposoir était dressé. Le prêtre, à la fin de la messe, partait du Bourg, de l’église, suivi de tous les
paroissiens. Il y avait un premier reposoir au Bourg, puis l’on montait tout droit par le chemin des Remparts. Le prêtre marchait devant sous un dais porté par
quatre hommes qui étaient aussi des chantres ; suivaient les chœurs d’hommes et de femmes ; puis des petites filles jetaient par intermittence des fleurs puisées à
leurs corbeilles : mademoiselle Métral, l’institutrice de l’école libre, leur donnait le signal en faisant claquer un livre de bois. On arrivait à La Place. On passait
sous l’arc de triomphe élevé entre les maisons Lebreton et Dumoulin. Premier arrêt de prières au reposoir qui était dressé entre les maisons Dumoulin ( = Buchet-Bailly) et Chervier (= Delomier-Martin, détruite en 1998). Puis on prenait à droite, pour rejoindre le deuxième reposoir
du hameau, sous les épicéas du côté de la
Raterie. Le troisième reposoir était dressé dans le large carrefour au coin de l’hôtel-charcuterie. La procession repartait ensuite vers le premier reposoir, où il y
avait de nouveau un arrêt de chant et de prière. Tous les angles de hameau étaient fermés par de grands draps blancs de lin, dont c’était l’unique emploi. Ces draps,
et les piliers de bois qui servaient à construire les reposoirs, étaient remisés année après année dans les maisons de tel ou tel particulier du hameau qui en avait la
responsabilité.
Que j’ai aimé ce hameau, où j’ai habité presque continuellement — sauf durant mon temps d’apprentissage à Chauffailles et à Lyon — de ma naissance jusqu’à
l’âge de vingt-huit ans, ce hameau où j’ai ouvert, en 1932, mon premier magasin de mécanique et de cycles (dans l’actuelle maison Bonnavent), ce hameau enfin
où la vie était si remplie de joie amicale !
Novembre 1998
Articles Monographie
Etude étymologique
1836 : Un bébé abandonné
La donation André 1857
Un "conflit d'intérêts" - 1873
Annuaire administratif - 1914
La vie sportive
La bascule de La Place - 1919
Abonnés au téléphone - 1928
Le petit théâtre de Coublanc
Prix André Druère - 1967
Bulletin municipal de 1974
Commerces et artisans - 1978
Salle pour Tous - 1980
Divers anciens actes notariés
Textes de C. M Dessertine
Le vignoble à Coublanc en 1900
Le blé à Coublanc début 1900
Histoire de La Place